Stephen Hawking n’a pas pu bouger à cause d’une maladie neurodégénérative appelée sclérose latérale amyotrophique (SLA), diagnostiquée à l’âge de 21 ans. Cette maladie a progressivement paralysé son corps, jusqu’à ce qu’il perde presque totalement sa mobilité physique.
La cause de l’immobilité de Stephen Hawking
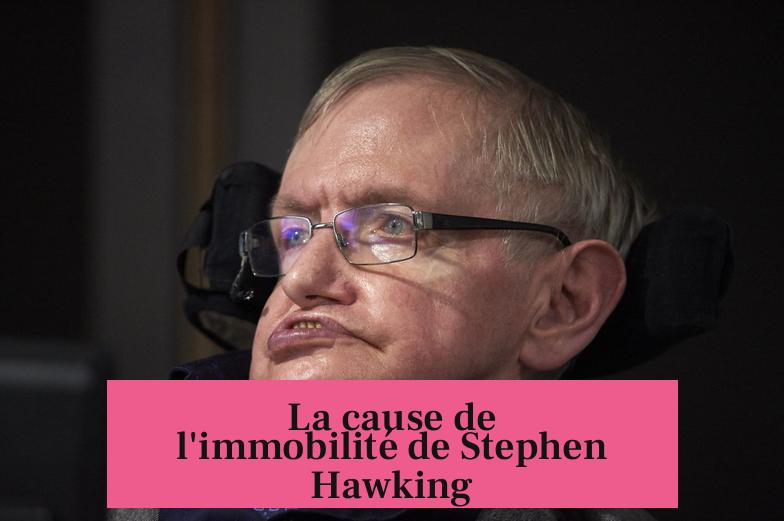
Stephen Hawking souffrait de SLA, une forme de maladie du motoneurone. Cette pathologie détruit lentement les neurones moteurs responsables du contrôle des muscles. Progressivement, Hawking a perdu la capacité de bouger ses membres, puis de parler.
- 1963 : Diagnostic à l’université de Cambridge, avec une espérance de vie de quelques années.
- 1969 : Nécessité d’un fauteuil roulant, mobilité déjà très limitée.
- Fin des années 1970 : Incapacité quasi totale de mouvement et de parole.
- 1985 : Perte complète de sa voix après une opération salvatrice.
La SLA a ainsi rendu impossible tout mouvement volontaire, l’enfermant dans un corps immobile.
Les technologies au service de la communication et du mouvement
Malgré son immobilité, Hawking a communiqué grâce à des solutions technologiques innovantes. Il est passé d’un tableau pour épeler des mots à un système informatique complexe.
Les premières aides à la communication
- Utilisation d’un tableau pour sélectionner les lettres avec un mouvement de sourcil.
- Un dispositif générateur de voix contrôlé d’abord par un interrupteur manuel.
- Puis, un système détectant un muscle de la joue via un capteur infrarouge fixé à ses lunettes.
Évolutions technologiques
Les systèmes informatiques permettant la synthèse vocale ont été optimisés en continu, notamment avec le soutien d’Intel. Un logiciel prédictif a accéléré la composition des phrases, utilisant l’intelligence artificielle pour anticiper les mots suivants.
Exemple d’amélioration : en 2008, le « switch joue » offrait un contrôle plus fin sur la sélection des caractères, malgré une mobilité musculaire quasi nulle.
Limitations et défis
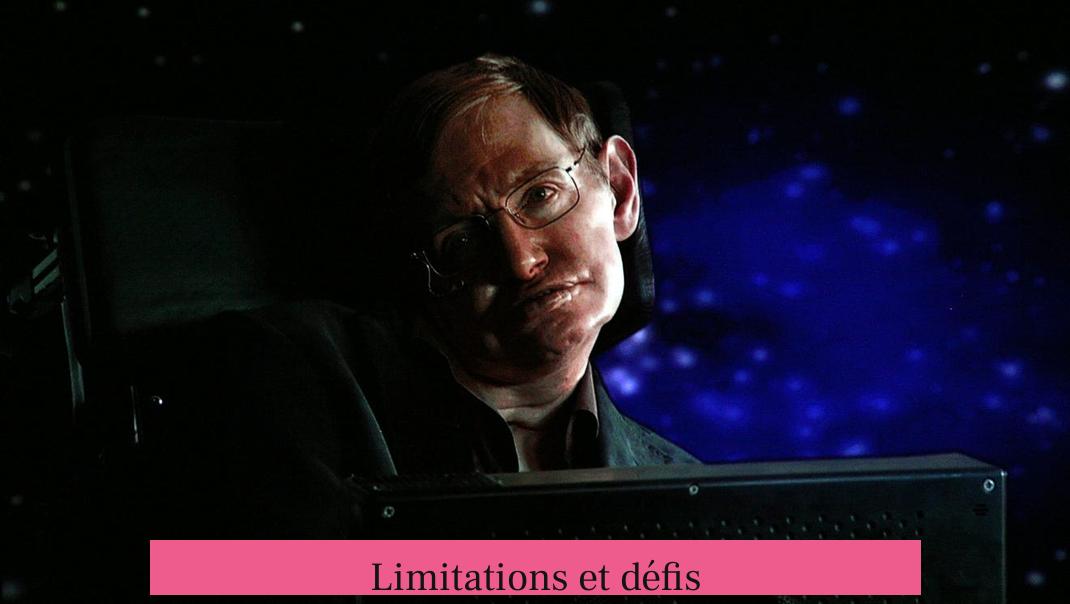
- Les tentatives de suivi oculaire ont échoué à cause des paupières tombantes.
- L’électroencéphalogramme n’a pas capturé de signaux suffisamment forts pour diriger un ordinateur par pensée.
- La vitesse de communication restait lente (environ 15 mots par minute à son apogée).
Impact de la paralysie sur la vie quotidienne
Sa paralysie a nécessité une assistance permanente, notamment de la part d’infirmiers et d’aides. Ses capacités motrices étant très limitées, même diriger son fauteuil roulait demeurait ardu.
Malgré cela, Hawking a maintenu sa carrière scientifique. Il enseignait, écrivait des ouvrages et intervenait publiquement grâce à ses systèmes de communication.
Un esprit libre dans un corps paralysé
Stephen Hawking exprimait que, malgré son incapacité à bouger, son esprit restait libre. Il utilisait souvent la phrase :
« Bien que je ne puisse pas bouger et que je doive parler par ordinateur, dans ma tête je suis libre. »
Cette liberté mentale a nourri son travail et son engagement scientifique jusqu’à la fin de sa vie.
Récapitulatif des éléments clés
- La paralysie de Hawking résulte de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), une maladie neurodégénérative.
- La perte progressive du mouvement a commencé dès le diagnostic en 1963, culminant avec une perte totale de mobilité et de parole dans les années 1980.
- Il a utilisé des technologies évolutives pour communiquer, passant des mouvements de sourcils à des systèmes informatiques sophistiqués.
- Malgré la paralysie, Hawking a conservé ses facultés intellectuelles et mentales intactes, continuant à contribuer à la science.
- Son expérience illustre les avancées technologiques en assistance aux personnes en situation de handicap sévère.
Pourquoi Stephen Hawking ne pouvait-il pas bouger ?
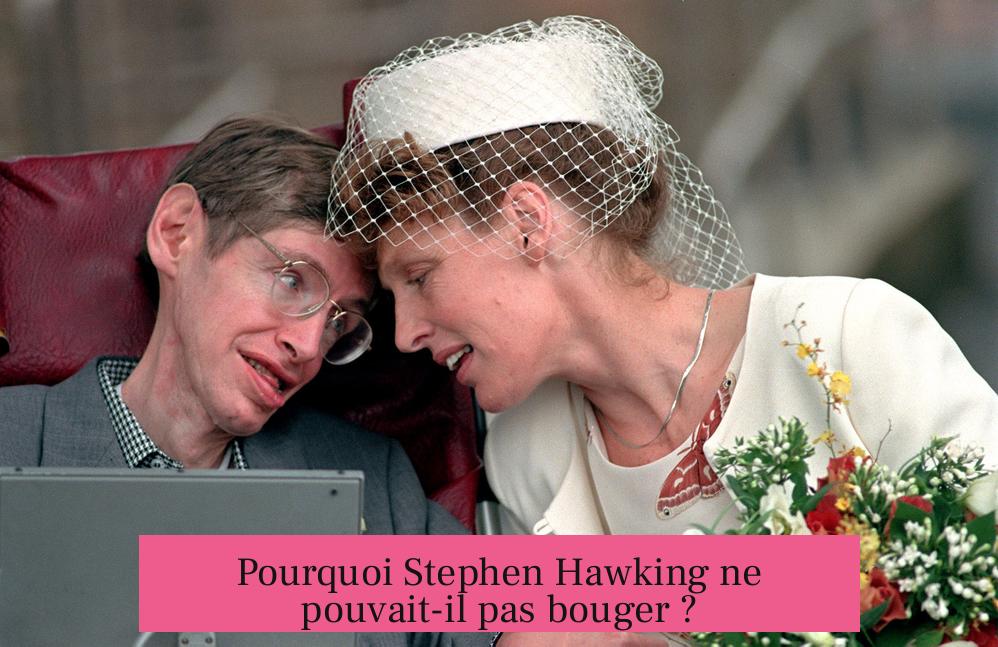
Stephen Hawking ne pouvait pas bouger en raison d’une maladie neurodégénérative appelée sclérose latérale amyotrophique (SLA), ou maladie du neurone moteur, qui l’a peu à peu paralysé depuis son diagnostic à 21 ans. Cette affection a détruit ses capacités motrices, le clouant dans un fauteuil roulant et supprimant son aptitude à parler, ce qui a nécessité des technologies très avancées pour qu’il communique.
Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, imaginez : un physicien théoricien, dont l’esprit voyage parmi les étoiles et les singularités des trous noirs, coincé dans un corps qui lui refuse tout mouvement. Un paradoxe saisissant.
La révélation d’un destin brutal dès 1963
Stephen Hawking débute ses études de cosmologie à Cambridge, jeune et plein d’avenir. C’est là qu’il rencontre Jane, sa première épouse. L’année 1963 bouleverse tout. Diagnostiqué avec une forme peu commune et à progression lente de la SLA, les médecins lui donnent environ deux ans à vivre.
Imaginez un diagnostic aussi catastrophique à 21 ans. Ce qui aurait pu tuer son ambition, le plonge dans une sombre dépression. Pourtant, Hawking repousse ce pronostic, défiant la maladie et ses limites physiques.
L’impact de la SLA sur ses capacités motrices : un déluge progressif
À partir de la fin des années 60, son corps se rebelle davantage. En 1969, il doit abandonner la marche, faute de pouvoir contrôler ses muscles, et s’installe dans un fauteuil roulant. La déficience motrice s’amplifie.
Dans les années 70, sa voix se fait rare, et en 1985 survient une intervention d’urgence. Après une trachéotomie pour sauver sa vie, il perd définitivement la parole.
Ce fut un changement radical, car, du jour au lendemain, il ne peut plus s’exprimer verbalement. Il s’appuie désormais sur des outils technologiques pour communiquer et poursuivre ses recherches.
Un cerveau libre, un corps prisonnier
Malgré cette lente dégradation de ses capacités physiques, Hawking affirme souvent : « Bien que je ne puisse pas bouger et que je doive parler par ordinateur, dans mon esprit je suis libre. » Ces mots résonnent comme une défiance aux limites imposées par son corps.
Il incarne la preuve que le confinement dans un corps handicapé ne signifie pas emprisonnement total. Son esprit, lui, voyage encore, explorant l’univers et partageant ses idées avec le public.
Comment communiquait-il ? Le génie des technologies adaptées

La communication, primordial pour un homme de science et de médias, s’appuyait sur des appareils toujours plus perfectionnés. Au départ, des tableaux d’épellation permettaient à Hawking de sélectionner lettres par lettres en levant un sourcil ou en utilisant un muscle facial.
Le tournant majeur arriva avec l’invention de logiciels comme Equalizer, brodé sur un Apple II et conçu pour traduire ses sélections en parole synthétique. Puis vint EZ Keys, un système à clavier virtuel avec prédiction de mots, afin d’accélérer la frappe.
Au fil du temps, les outils se particularisèrent pour correspondre à ses capacités physiques décroissantes. Il utilisa un système fixé sur son fauteuil, puis un capteur infrarouge attaché à ses lunettes. Ce dernier détectait les mouvements microscopiques de sa joue pour écrire des textes ou piloter son fauteuil roulant.
| Année | Technologie | Fonction |
|---|---|---|
| Années 1980 | Equalizer sur Apple II | Traduction de texte en parole synthétique |
| Années 1990 | EZ Keys | Clavier virtuel avec prédiction de mots |
| 2008 | Capteur infrarouge sur lunettes (‘cheek switch’) | Détection des mouvements de joue pour écrire |
Intel, l’un des sponsors technologiques, assure un renouvellement régulier des ordinateurs et met au point des logiciels intégrant des algorithmes intelligents devinant les mots suivants. Ce dispositif est vital pour maintenir une fluidité dans ses échanges, car vers 2011, Hawking ne pouvait prononcer que deux mots par minute.
La lutte quotidienne : entre hospitalisations et dépendance
La SLA signifie un déclin progressif des fonctions motrices — Hawking perd, peu à peu, toute capacité à bouger. Même conduire son fauteuil roulant devient une épreuve, son cou presque figé rendant la manœuvre imprévisible.
Les difficultés respiratoires s’ajoutent aux troubles moteurs. Vers la fin de sa vie, il dépend de ventilateurs et de soins hospitaliers réguliers. Cela souligne l’importance du soutien médical et humain qui l’a accompagné.
Un mental indomptable et un sens de l’humour vif
« Hawking utilisait souvent les caprices de son système informatique pour taquiner ceux qui l’entouraient, montrant qu’il gardait son esprit vif et son humour malgré son état. »
Son attitude à la vie fascine autant que ses travaux scientifiques. Il a su sublimer sa paralysie en devenant un symbole mondial de résilience. Il détestait que son handicap prédomine sa personne.
À cette fin, il acceptait volontiers sa voix artificielle, surnommée ‘Perfect Paul’, dessinée en 1980 par Dennis Klatt. Sa signature sonore était une petite touche d’humanité dans son existence numérique.
Des pensées au-delà des limites physiques
Stephen Hawking nous rappelle que le corps peut être prisonnier, mais l’esprit, lui, peut s’élever. Sa contribution à la cosmologie, malgré sa condition, prouve que le handicap ne limite pas l’intellect ni la créativité.
Il pose une question importante : qu’est-ce que vraiment « bouger »? Si nous considérons uniquement le physique, Hawking ne bougeait pas. Mais dans ses idées, ses émotions et ses découvertes, il ne s’est jamais arrêté.
Qu’apprenons-nous de cette histoire ?
- La SLA, une maladie dévastatrice, peut réduire peu à peu les capacités motrices, allant jusqu’à l’invalidité totale.
- L’adaptation technologique permet de surmonter d’énormes obstacles, révélant le lien fort entre innovation et humanité.
- La force mentale est décisive dans la confrontation avec la maladie.
- La communauté scientifique et les proches sont un socle essentiel au maintien d’une vie digne et active.
- Enfin, Hawking incarne la liberté d’esprit, même quand le corps abandonne.
En somme, Stephen Hawking ne pouvait pas bouger à cause de la SLA, mais son esprit, lui, ne s’est jamais arrêté de voyager dans les étoiles.
Pourquoi Stephen Hawking ne pouvait-il pas bouger ?
Il souffrait de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), une maladie neurodégénérative qui a progressivement paralysé son corps. Cette maladie a détruit ses neurones moteurs, le rendant incapable de bouger.
Comment la SLA a-t-elle affecté ses capacités motrices au fil du temps ?
Diagnostiqué en 1963, Hawking a commencé à perdre l’usage de ses muscles progressivement. Dès 1969, il a utilisé un fauteuil roulant et dans les années 1970, il ne pouvait presque plus bouger ni parler.
Comment communiquait-il malgré son immobilité ?
Après la perte de la parole, il utilisait un dispositif de synthèse vocale contrôlé par un muscle de la joue. Ce système a été amélioré avec la technologie pour lui permettre de taper et parler lentement.
Pourquoi n’a-t-il pas pu utiliser un suivi oculaire pour son ordinateur ?
Vers la fin, ses paupières tombaient, rendant impossible le suivi du regard. De plus, son signal cérébral n’était pas assez fort pour contrôler l’ordinateur par EEG.
Quelle était son attitude face à cette paralysie ?
Hawking disait que bien qu’il soit incapable de bouger ou de parler sans aide, il se sentait libre dans son esprit. Il n’a jamais laissé sa maladie freiner son travail ni sa curiosité.

