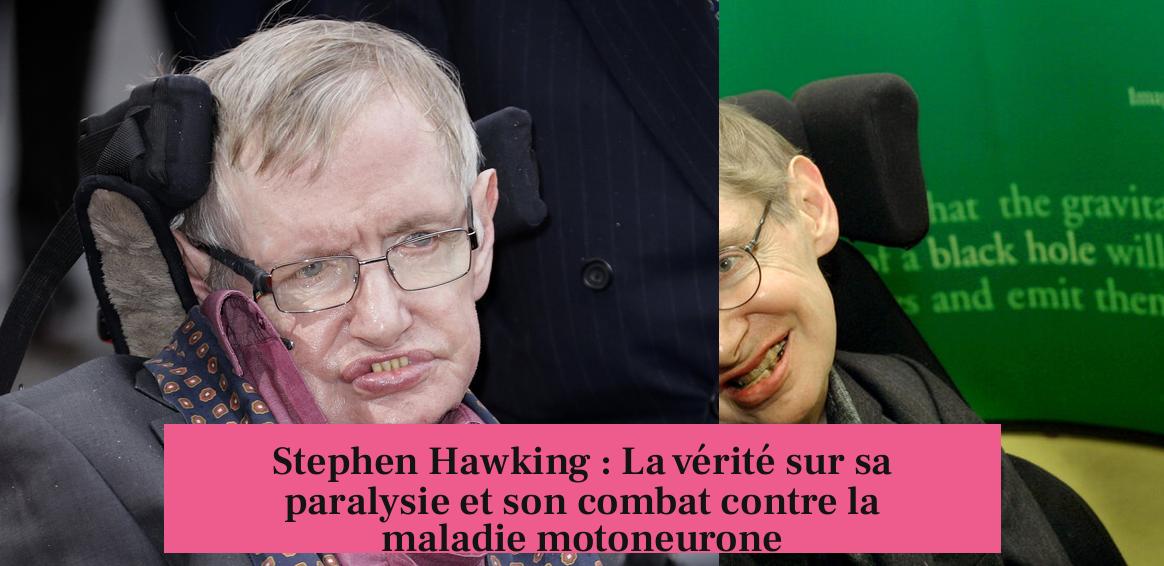Comment Stephen Hawking est-il devenu paralysé ?
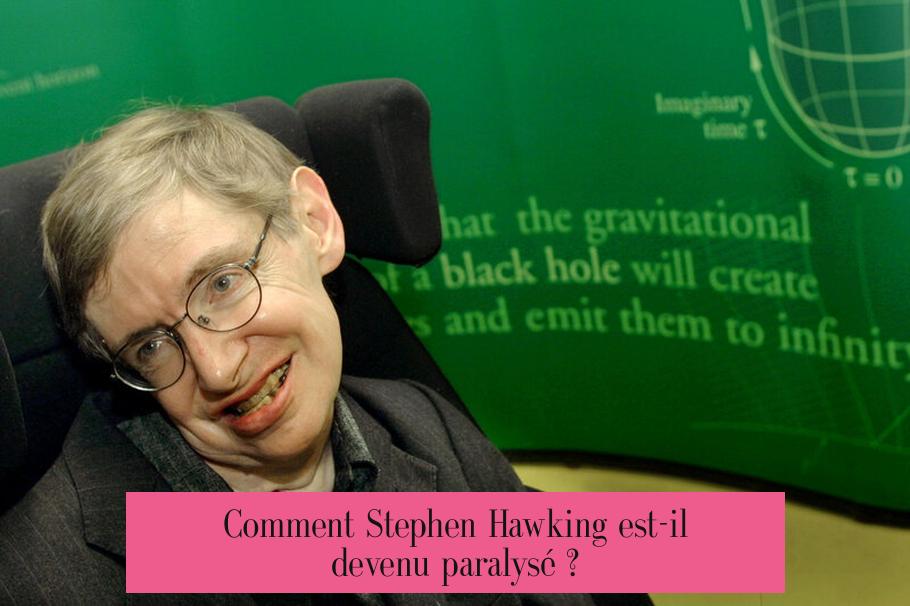
Stephen Hawking est devenu paralysé à cause d’une sclérose latérale amyotrophique (SLA), une maladie neurodégénérative progressive qui détruit les motoneurones et entraîne une perte progressive du contrôle musculaire. Diagnostiqué à 21 ans en 1963, il a vécu plus de cinq décennies avec cette maladie, ce qui est exceptionnel.
Diagnostic de la maladie motoneurone
À 21 ans, Stephen Hawking commence à ressentir des symptômes inquiétants : difficulté à marcher de façon stable, faiblesse musculaire, troubles de la parole.
- Il est diagnostiqué avec une forme précoce et à progression lente de la SLA.
- Cette maladie affecte les cellules nerveuses contrôlant les muscles, causant une paralysie progressive.
- Initialement, les médecins estimaient une espérance de vie de deux ans, un pronostic finalement incorrect.
Évolution des symptômes et paralysie
La SLA a progressivement paralysé Hawking sur plusieurs décennies :
- Il perd peu à peu la capacité de marcher sans aide.
- Sa parole devient presque incompréhensible avant de disparaître totalement.
- Une intervention en 1985, une trachéotomie suite à une pneumonie, entraîne la perte définitive de sa voix.
- Il communique alors via un dispositif électronique contrôlé par un muscle de sa joue.
- Vers la fin, il est entièrement dépendant d’un fauteuil roulant et de soins constants.
Caractéristiques atypiques de la maladie chez Hawking
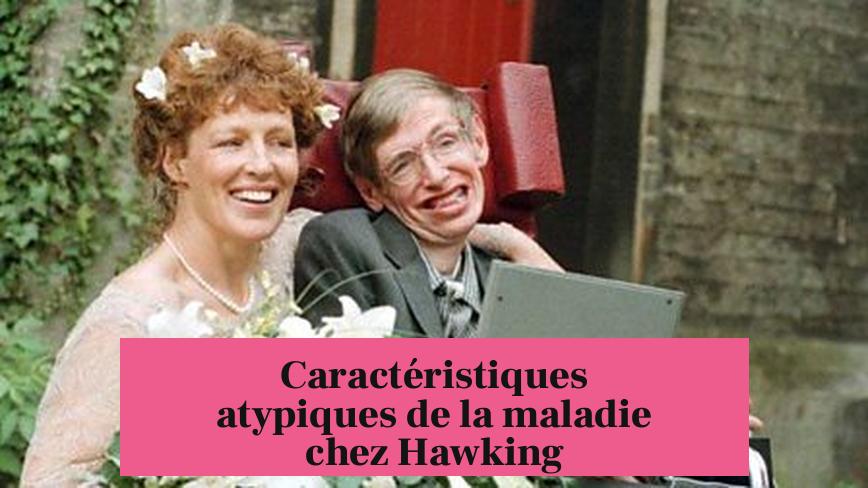
La progression lente et la longévité exceptionnelle de Hawking sont rares :
- La SLA cause généralement la mort en 3 à 5 ans après diagnostic.
- Seulement 5 % des patients vivent au-delà de 20 ans.
- Stephen Hawking a vécu plus de 50 ans avec la maladie, défiant les statistiques.
- Sa survie prolongée pourrait être liée à ses gènes, son environnement, et la qualité des soins reçus.
- Il a évité aussi la démence souvent associée aux stades avancés.
Impact sur la vie personnelle et professionnelle
Malgré sa paralysie, Hawking a maintenu une carrière scientifique active et brillante :
- Il continue ses recherches en cosmologie et physique théorique.
- Il atteint un renom mondial et publie des ouvrages majeurs.
- Son état requiert une assistance quotidienne, fournie par des équipes de soins spécialisées.
- La technologie lui permet de communiquer et de contribuer intellectuellement.
Résilience psychologique
Le diagnostic initial le déprime, mais il reprend courage :
« Avant la maladie, la vie m’ennuyait. La menace de la mort m’a montré que la vie vaut la peine d’être vécue. » — Stephen Hawking
Son engagement personnel et passion pour la physique ont nourri sa détermination.
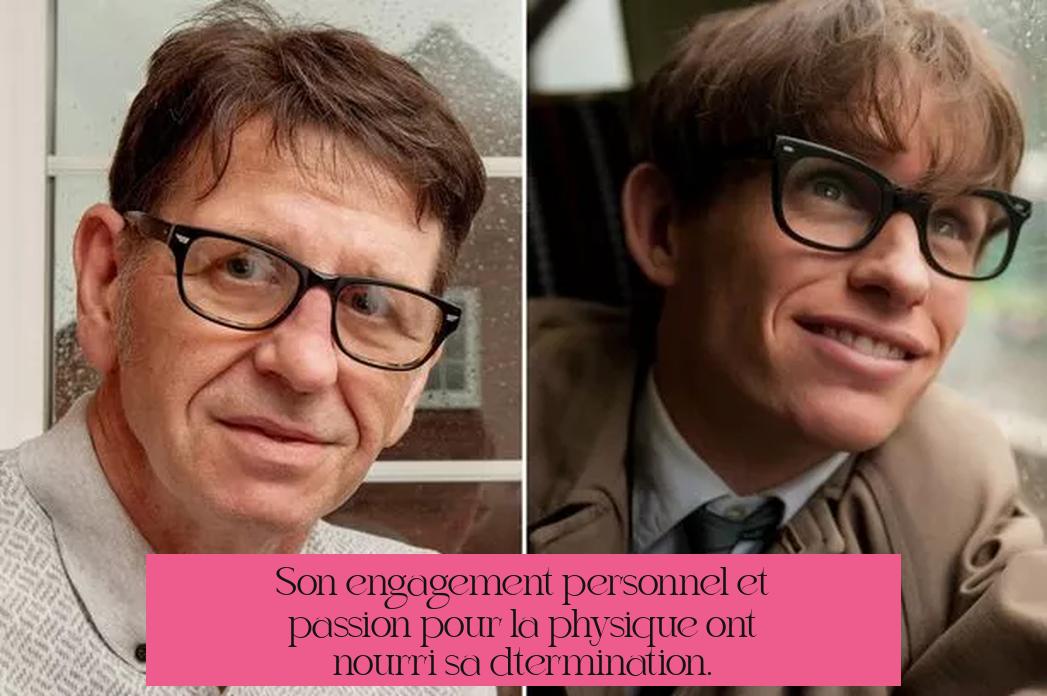
Soins médicaux et soutien
- Sa survie prolongée est partiellement due à un suivi médical intensif.
- Il bénéficie de soins infirmiers 24 heures sur 24.
- Des appareillages tels que ventilateurs et dispositifs de communication sont essentiels.
- Le soutien financier, notamment par des droits d’auteur, a permis un accès à ces services.
Résumé des points clés
- Stephen Hawking est devenu paralysé à cause de la sclérose latérale amyotrophique, diagnostiquée en 1963.
- La maladie a provoqué une paralysie progressive, avec une perte totale de la parole à partir de 1985.
- Sa forme de SLA à progression lente est exceptionnelle, lui permettant de vivre plus de 50 ans.
- Il a maintenu une carrière scientifique active grâce à sa détermination et à la technologie.
- Un soutien médical continu et spécialisé a été crucial pour sa longévité.
Comment Stephen Hawking est-il devenu paralysé ? La vérité derrière son combat avec la maladie
Stephen Hawking est devenu paralysé à cause de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), une forme progressive de maladie neurodégénérative qui a peu à peu détruit ses capacités motrices, le confinant finalement à un fauteuil roulant et lui faisant perdre la parole. Diagnostiqué à l’âge de 21 ans, à peine au début de sa carrière universitaire, Hawking a vécu avec cette maladie plus de 50 ans, défiant toutes les attentes médicales.
Mais comment exactement cette paralysie s’est-elle installée ? Et comment un tel diagnostic précoce a-t-il influencé sa vie extraordinaire ? Accrochez-vous, le parcours de Hawking est à la fois bouleversant et captivant.
Le diagnostic : un choc à 21 ans

En 1963, Stephen Hawking entre dans la vingtaine et commence ses recherches en mathématiques appliquées et physique théorique, particulièrement en relativité générale et cosmologie. C’est durant cette période prometteuse, alors qu’il étudie à Cambridge, qu’un diagnostic tombe : une forme précoce et à progression lente de la maladie des neurones moteurs, autrement dit la SLA, aussi connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig.
Cette maladie neurodégénérative attaque directement les neurones responsables du contrôle musculaire volontaire. Pour Hawking, ses premiers symptômes incluent une démarche instable, une faiblesse musculaire, des troubles de l’élocution et des pertes d’équilibre – dont la conséquence fâcheuse d’une chute où il se casse les dents de devant.
Le pronostic initial était lourd : on lui accordait deux ans à vivre. Pourtant, cette période limitée s’est muée en une remarquable survie sur plus de cinq décennies.
Une progression lente mais implacable
À l’inverse de la plupart des patients atteints de SLA, dont la survie moyenne est d’environ 3 à 4 ans, Hawking présente une forme atypique à progression lente. La paralysie s’installe pas à pas. Son corps subit les assauts du temps, perdant peu à peu mobilité et force.
Au fil des années, son discours devient presque incompréhensible. La maladie détruit l’usage de ses muscles, le poussant à dépendre d’un fauteuil roulant. Enfin, en 1985, une infection pulmonaire grave contre laquelle il lutte, le conduit à une trachéotomie. Cet acte médical, destiné à faciliter la respiration via un ventilateur, lui fait perdre définitivement sa voix naturelle.

La technologie comme vecteur de communication
Mais Hawking ne laisse pas la maladie réduire son génie au silence. Grâce aux progrès technologiques, il utilise un dispositif générateur de parole. D’abord commandé par un interrupteur manipulé à la main, il adapte ce système incroyable pour qu’il n’ait besoin que d’un seul muscle de la joue. Le mélange entre technologie et détermination offre à Hawking une voix qui, bien que robotique, véhicule ses idées brillantes.
Un état rare : la survie exceptionnelle
La longévité de Stephen Hawking dans ces conditions est une exception médicale. Seulement 5 % des patients vivant avec la SLA dépassent les 20 ans de survie. Vivre plus de 50 ans et continuer à faire des recherches de pointe reste aujourd’hui presque unique.
Cette longévité pourrait s’expliquer par un cocktail complexe incluant génétique, environnement, qualité des soins médicaux et force psychologique. Ses neurones moteurs oculaires furent probablement moins affectés, ce qui lui permit de garder une forme de communication non verbale, essentielle à sa survie et son travail.
L’impact émotionnel et le combat psychologique

Le diagnostic fut un coup dur, plongeant Hawking dans une dépression profonde. Pourtant, soutenu par ses médecins et encouragé par son mentor Dennis Sciama, il décide de poursuivre ses études et sa carrière. Cette décision marque un tournant crucial où Hawking voit dans son combat contre la maladie une raison de vivre encore plus intensément.
« Avant la SLA, je m’ennuyais parfois de la vie, mais la perspective d’une mort précoce m’a poussé à comprendre que chaque instant compte. » – Stephen Hawking
Sa résilience mentale, son humour et sa passion pour la science l’aident à traverser les moments difficiles. Même paralysé, il continue de participer à des conférences, écrire des livres et développer des théories révolutionnaires, notamment sur les trous noirs et l’origine de l’univers.
Un soutien médical constant : un pilier de sa survie
Le soin apporté à Stephen Hawking fut intensif et continu. Il bénéficiait d’une prise en charge 24 heures sur 24 par une équipe médicale et des aides-soignants. Ces soins incluent kinésithérapie, assistance respiratoire, physiothérapie et soutien pour prévenir les complications grippales ou infectieuses.
Ces services sont onéreux et souvent non remboursés par les assurances de santé classiques, ce qui souligne encore plus les moyens exceptionnels et la reconnaissance dont Hawking bénéficiait grâce à son statut et ses histoires à succès (livres à succès, subventions, interventions médiatiques).
Un héritage au-delà de la paralysie
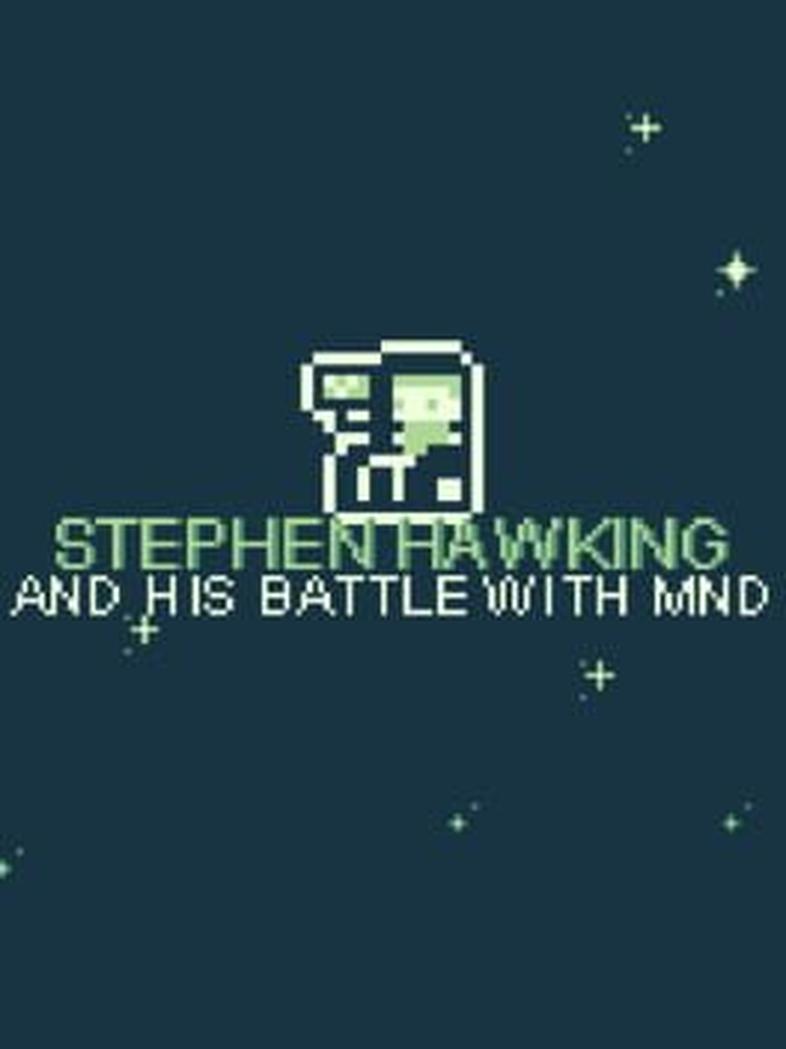
Malgré l’ampleur de sa paralysie, Stephen Hawking retrouve le moyen d’exprimer sa pensée, d’explorer l’univers avec son intellect inégalé et laisse derrière lui un héritage scientifique majeur. Sa maladie a marqué son corps, mais jamais son esprit.
Il déjoue les pronostics, inspire la communauté scientifique et les personnes atteintes de handicaps. Son combat personnel questionne aussi nos systèmes médicaux et sociaux: comment soutenir les malades incurables tout en leur permettant de rester acteurs de leur vie?
Conclusion : une paralysie, mais pas une défaite
Pour résumer :
- Stephen Hawking est devenu paralysé à cause de la SLA, diagnostiquée dès ses 21 ans.
- La maladie a causé une perte progressive du contrôle musculaire, le confinant à un fauteuil roulant et le rendant incapable de parler naturellement.
- Sa forme particulière, lente et atypique, sa détermination sans faille, ainsi que les avancées technologiques et un suivi médical rigoureux ont prolongé sa vie au-delà de tous les pronostics.
- Il reste un exemple d’incroyable résilience et d’intellect brillant, prouvant que le corps peut être limité sans que l’esprit ne soit jamais prisonnier.
Alors, la prochaine fois que vous vous demandez comment Stephen Hawking est devenu paralysé, souvenez-vous : ce n’est pas juste une maladie qui l’a défini, mais une extraordinaire leçon d’endurance face à l’adversité.
Comment Stephen Hawking a-t-il été paralysé?
Stephen Hawking a été diagnostiqué avec une forme de sclérose latérale amyotrophique (SLA) en 1963, à 21 ans. Cette maladie neurodégénérative progresse lentement et a causé sa paralysie progressive sur plusieurs décennies.
Quels ont été les premiers symptômes de la maladie de Hawking?
Il a d’abord montré des troubles de la marche, une faiblesse musculaire et des difficultés d’élocution. Ces symptômes se sont aggravés avec le temps, affectant son équilibre et sa capacité à parler sans assistance.
Pourquoi la paralysie de Hawking a-t-elle évolué plus lentement que prévu?
La forme de SLA dont il souffrait était atypique et progressait lentement. Son long éventail de survie, plus de 50 ans, est exceptionnel, dû à des facteurs génétiques, son suivi médical intensif et sa résistance mentale.
Comment Hawking a-t-il continué à communiquer malgré sa paralysie?
Après avoir perdu la parole, il a utilisé un dispositif générateur de voix contrôlé d’abord par une main, puis par un muscle de la joue. Ce système lui a permis de continuer à s’exprimer et à travailler.
Quels soins ont permis à Hawking de vivre aussi longtemps avec sa paralysie?
Il a bénéficié de soins infirmiers constants, d’appareils médicaux pour la respiration et de thérapies diverses. Son traitement incluait aussi une trachéotomie après une pneumonie, essentielle pour sa survie prolongée.
Quel rôle a joué la maladie dans la vie professionnelle de Hawking?
Malgré la paralysie, il a poursuivi ses recherches en physique théorique. Sa maladie l’a poussé à adopter une approche plus intuitive et spéculative de la science, et il a collaboré avec de nombreux chercheurs jusqu’à la fin de sa vie.